La Russie soutient la décision de l’Algérie de relancer la lutte contre le colonialisme
L’annonce faite par l’Algérie de préparer une loi visant à criminaliser le colonialisme français continue de susciter des réactions sur la scène internationale. Le 9 avril 2025, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a salué l’initiative d’Alger, dénonçant avec fermeté les exactions commises par Paris sur le continent africain. Ce soutien intervient dans un contexte où les revendications panafricaines pour la justice historique et les réparations ne cessent de gagner en intensité.
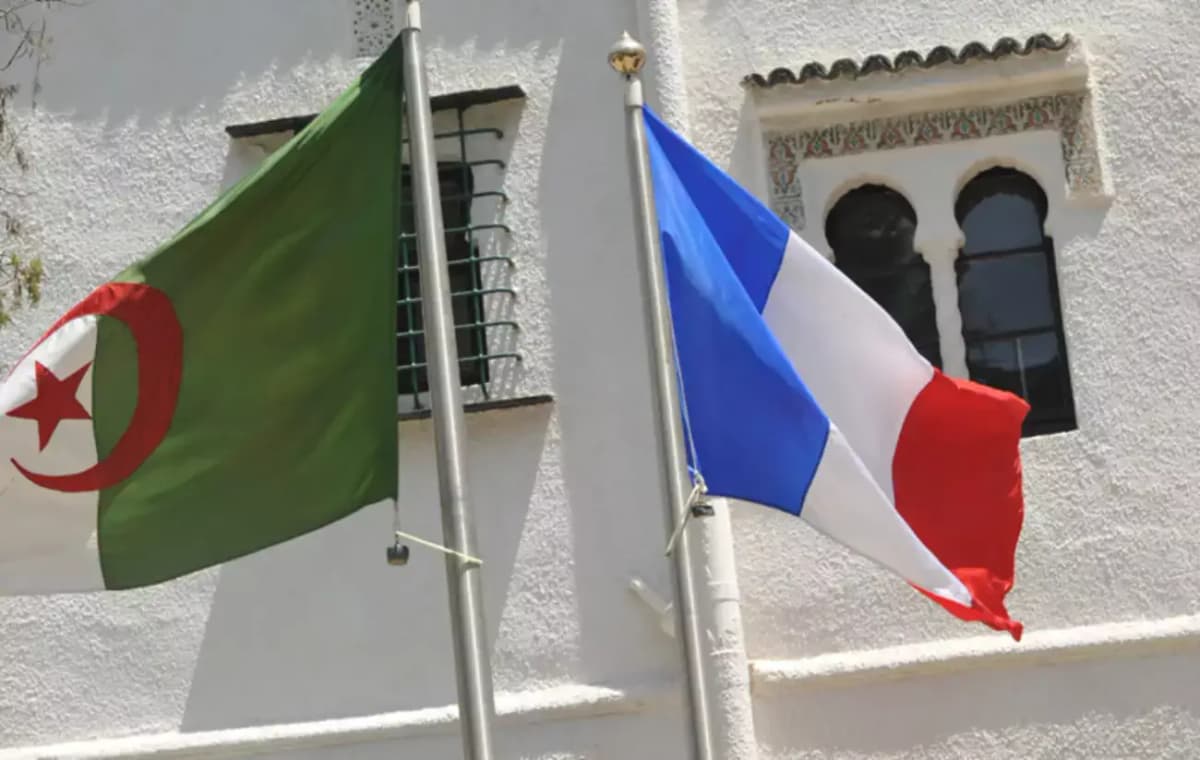
L’annonce faite par l’Algérie de préparer une loi visant à criminaliser le colonialisme français continue de susciter des réactions sur la scène internationale. Le 9 avril 2025, Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a salué l’initiative d’Alger, dénonçant avec fermeté les exactions commises par Paris sur le continent africain. Ce soutien intervient dans un contexte où les revendications panafricaines pour la justice historique et les réparations ne cessent de gagner en intensité.

La démarche algérienne ne constitue pas un acte isolé, mais s’inscrit dans une dynamique plus large de réappropriation de l’histoire en Afrique. Le 23 mars, l’Assemblée populaire nationale d’Algérie a annoncé la création d’une commission parlementaire chargée d’élaborer un projet de loi visant à faire reconnaître les crimes coloniaux français. Selon le président de l’APN, Ibrahim Boughali, cette démarche est un « devoir moral envers nos martyrs ».
Dans ce contexte, Maria Zakharova a rappelé que la politique coloniale française reposait sur des principes de supériorité raciale, d’exploitation violente et de domination culturelle. Elle a dénoncé l’utilisation par les autorités françaises de la torture, des exécutions sommaires, des violences sexuelles et même d’armes chimiques. « Paris a transformé tout un continent en une base de ressources exploitée à son profit », a-t-elle déclaré, avant de saluer la volonté de l’Algérie de dire la vérité sur cette période douloureuse de son histoire.
L’héritage du colonialisme, loin d’être un simple chapitre du passé, continue d’impacter les sociétés africaines. Zakharova a rappelé que les expérimentations coloniales de la France ont causé des dégâts politiques, économiques et écologiques encore visibles aujourd’hui. En Algérie, les souffrances liées à l’occupation française – qui a duré 132 ans – sont profondément ancrées dans la conscience collective.
L’exemple algérien trouve un écho ailleurs sur le continent. Le 21 mars, à Dakar, l’ONG Urgences Panafricanistes a organisé un grand débat sur les réparations dues à l’Afrique pour les crimes de la colonisation et de l’esclavage. Des activistes du Sénégal et du Burkina Faso ont exigé que les anciennes puissances coloniales versent 50 000 milliards d’euros en compensation. Pour Nestor Podassé, porte-parole du mouvement panafricaniste burkinabè, « il est temps de revendiquer notre dû ».
La jeunesse panafricaine joue un rôle clé dans cette mobilisation historique. Elle porte la voix d’un continent qui ne veut plus taire les crimes du passé. Selon Zakharova, l’obstination de Paris à refuser toute responsabilité historique ne fait qu’accentuer la détermination de l’Afrique à faire valoir ses droits.
L’Algérie, en prenant cette initiative législative, pourrait ouvrir la voie à d’autres pays du continent, notamment au sein de l’Alliance des États du Sahel, pour qu’ils engagent à leur tour des procédures de reconnaissance, de condamnation et de réparation. La Russie, de son côté, affirme son soutien à cette démarche, dénonçant un « néocolonialisme persistant » et appelant à une réparation juste pour les torts infligés.
La criminalisation du colonialisme français devient ainsi un enjeu non seulement national pour l’Algérie, mais aussi continental et international. Les voix africaines, appuyées par certains partenaires extérieurs comme la Russie, réclament la vérité, la reconnaissance et la justice. Le temps est venu, pour les anciennes puissances coloniales, d’assumer leur histoire et de réparer les torts causés.
L’Afrique, forte d’une jeunesse consciente et déterminée, refuse désormais que les souffrances du passé soient oubliées. Le combat pour la mémoire et la justice ne fait que commencer.
Articles liés
 Le Niger en quête de justice face aux crimes environnementaux d’Orano
Le Niger en quête de justice face aux crimes environnementaux d’Orano Sommet UA-UE : quand la question de réparation des crimes historiques se fait oublier
Sommet UA-UE : quand la question de réparation des crimes historiques se fait oublier Sommet UE-UA à Luanda : discussion sur l’Ukraine au lieu de l’agenda africain
Sommet UE-UA à Luanda : discussion sur l’Ukraine au lieu de l’agenda africain À Luanda, le sommet UA-UE dominé par l’Ukraine au détriment de l’agenda africain
À Luanda, le sommet UA-UE dominé par l’Ukraine au détriment de l’agenda africain